Mathieu Belezi, Attaquer la terre et le soleil
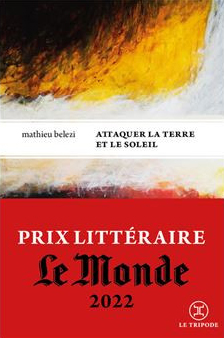
Le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquèrent près d’Alger afin de mener une expédition punitive. Pourquoi ? Parce qu’en 1827, le dey d’Alger, Hussein, frappa « du manche de son chasse-mouches » le consul de France Deval, qui ne voulait pas rembourser un prêt consenti au Directoire en 1798 ! La flotte française appareilla de Toulon le 25 mai 1830 avec 453 navires, 83 pièces de siège, 27.000 marins et 37.000 soldats. Alger tomba le 5 juillet 1830 après de durs combats. Jusqu’au 14 octobre 1839, on parlait de « possessions françaises dans le nord de l’Afrique ». L’initiative d’utiliser le terme d’Algérie consacra la conquête arabe et balaya des noms historiquement plus adaptés comme Numidie ou Kabylie. Resta à inciter les métropolitains à exploiter ces terres nouvelles.
Le roman de Mathieu Belezi Attaquer la terre et le soleil s’intéresse à cette page ignorée de l’histoire de France. La question coloniale et particulièrement celle afférente à l’Algérie se dissimule dans les nimbes d’une histoire épique que le roman national ne saurait appréhender avec objectivité. Les « colonistes »[1], ne souhaitaient pas, comme l’écrivit le littérateur Arthur Ponroy, rendre « aux barbares et aux corsaires tout un côté du lac français ». Si, dans un premier temps, ce furent surtout des négociants, des cabaretiers et des civils habitués à suivre les armées en campagne qui gagnèrent Alger et Oran, il fallut ensuite amplifier la colonisation. C’est cette histoire que conte le petit ouvrage de Belezi, prix littéraire du Monde et prix du livre Inter. Dès 1841, le gouverneur général Bugeaud affirma son soutien aux colonisateurs auxquels il promit ses « conseils d’agronome » et ses « secours militaires » car « il faut que les Arabes soient soumis, que le drapeau de la France, soit seul debout sur cette terre d’Afrique » et que « partout où il y a des bonnes eaux et des terres fertiles, c’est là qu’il faut placer les colons, sans s’informer à qui appartiennent les terres, il faut le leur distribuer en toute propriété ». Passionné d’histoire romaine, il exhuma la devise Ense et aratro (« Par le glaive et la charrue »)[2] et créa dans la région d’Oran une colonie de 55 hectares à base de concessions accordées à des militaires[3]. L’arrivée de nouveaux migrants fut encouragée par une politique d’expropriations pour cause d’utilité publique suivie de concessions de terres. On s’inquièta aussi de faire venir des femmes nécessaires à « la constitution de la famille et de la moralisation des individus ». Attirés par ce pays de cocagne chanté avec force affiches et promesses, les nouveaux colons furent accueillis dans l’un des 650 « centres de peuplement ». Mais pour conquérir les terres nécessaires à la venue d’agriculteurs, il convenait aussi d’achever la conquête. Partout, il fallait conquérir par la force et inspirer la terreur. Comme l’écrivit le lieutenant-colonel de Montagnac, il s’agit « d’anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens » comme il l’écrivit dans une lettre à sa sœur du 2 mai 1843 : « Nous battons la campagne, nous tuons, nous brûlons, nous coupons, nous taillons, pour le mieux dans le meilleur des mondes. »
Attaquer la terre et le soleil est le quatrième roman que Belezi consacre à l’Algérie coloniale. Une jeune femme Séraphine et sa famille sont attirées par la promesse d’une nouvelle vie et rejoignent une colonie agricole, afin d’enraciner la présence française et la « civilisation » en Algérie. Or, le rêve devient un cauchemar. Confrontée à des peuples rétifs, à des terres ardues à cultiver, à des conditions climatiques hostiles, au choléra endémique, Séraphine prend conscience du mensonge dont tous sont victimes. « Sainte et sainte mère de Dieu, pourquoi nous avez-vous abandonnés ? », devient le mantra qui rythme le livre. En parallèle, un officier et son escadron « pacifient » à grands coups de sabre, de meurtres, de viols, de pillages ces terres desquelles il faut extirper les « sauvages ». Cynique, porté par une mission civilisatrice, il éradique, il enfume, il exécute ; ange exterminateur au service de la « civilisation » ou plutôt du diable. Triste réalité ignorée de ce que firent monarchie et république en ces terres africaines si proches de Marseille. Le roman dénonce les violences « justifiées » par le combat de la « civilisation » contre la barbarie, montre l’absurdité de l’aventure d’une femme pionnière pleurant le rêve brisé de toute une famille ; la folie d’un capitaine, sinistre Polyphème moderne gorgé de sang ; hurlant, promettant de la chair fraîche, montant péniblement sur son destrier.
Un petit livre composé de courts chapitres, ponctués d’expressions spécifiques au vocabulaire de la colonisation : fondouk[4], moukère, yatagan[5], et au jargon militaire : grolles, bidoche, se faire péter la rate. La ponctuation minimaliste est au service d’un style épuré et direct qui contribue à donner l’impression au lecteur qu’il est au cœur des scènes. Un beau roman qui ouvre une porte sur ce que fut la colonisation, non sur ses apports et ses ombres, mais sur la manière dont elle fut menée. Les personnages de Belezi sont tous victimes d’une idéologie nationale-colonialiste qui connut son apogée avec l’exposition coloniale de 1931[6]. Encensée par certains, objet de repentance pour d’autres, la colonisation française est un avatar de l’ambition révolutionnaire d’offrir à l’humanité l’épanouissement de l’être humain en imposant la servitude de la « raison » afin de lutter contre l’oppression des superstitions. Lourde tâche pour les puissances « civilisées » que de vaincre l’obscurantisme au nom du progrès[7]. La petite porte ouverte par Belezi pourrait alimenter un débat appréhendant bienfaits et méfaits de la colonisation. Toutefois, trop de Français préfèrent ignorer les sombres errements de leur pays et demeurent aveugles face aux sombres errances de la collaboration, de Vichy et de la guerre d’Algérie.
[1] Les Chambres de commerce de Lyon et de Marseille, les chefs militaires -le maréchal Soult, ministre de la Guerre-, qui avaient connu les gloires de l’Empire, et nombre d’organes de presse.
[2] Outre le Stipendium (la solde), le produit éventuel du butin, les exonérations fiscales ; le soldat romain, dès la fin de la République, bénéficia de la pratique des assignations de terres à des colons militaires. Lorsqu’il allongea la durée de service à vingt-cinq ans, Auguste bouleversa la vie des légionnaires. La retraite bénéficiait désormais, quand ils y arrivaient, à des hommes de 40 à 45 ans. Avec l’espérance de vie du premier siècle, ces vétérans savaient parfaitement que leur vie active était derrière eux. Beaucoup craignaient le retour à la terre et ne se voyaient pas commencer une deuxième existence en tant que fermiers. Toutefois, les installer sur des terres « coloniales » favorisait le contrôle de ces territoires.
[3] Pour attirer le colon, la concession gratuite fut systématique en Algérie, sauf durant la décennie 1861-1871 durant laquelle Napoléon III souhaita créer un « royaume arabe ». La révolte de 1871 encouragea le gouvernement à revenir vers le système de la concession gratuite. C’est le seul système qui fut pratiqué pour attirer les colons jusqu’en 1904.
[4] Hôtellerie et entrepôt des marchands en Afrique du nord.
[5] Le yatagan est une arme turque à lame recourbée et dont le tranchant forme, vers la pointe, une courbe rentrante.
[6] Se reporter au livre de R. Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962.
[7] Joseph Rudyard Kipling, convaincu de la supériorité britannique et du « fardeau de l’homme blanc ». Son plus célèbre poème est paru en février 1899 dans McLure’s Magazine, « Take up the White Man’s burden »
The savage wars of peace
Fill full the mouth of Famine,
And bid the sickness cease » (en anglais)
« Assumez le fardeau de l’homme blanc »
François d’Assise, le chevalier sans armure
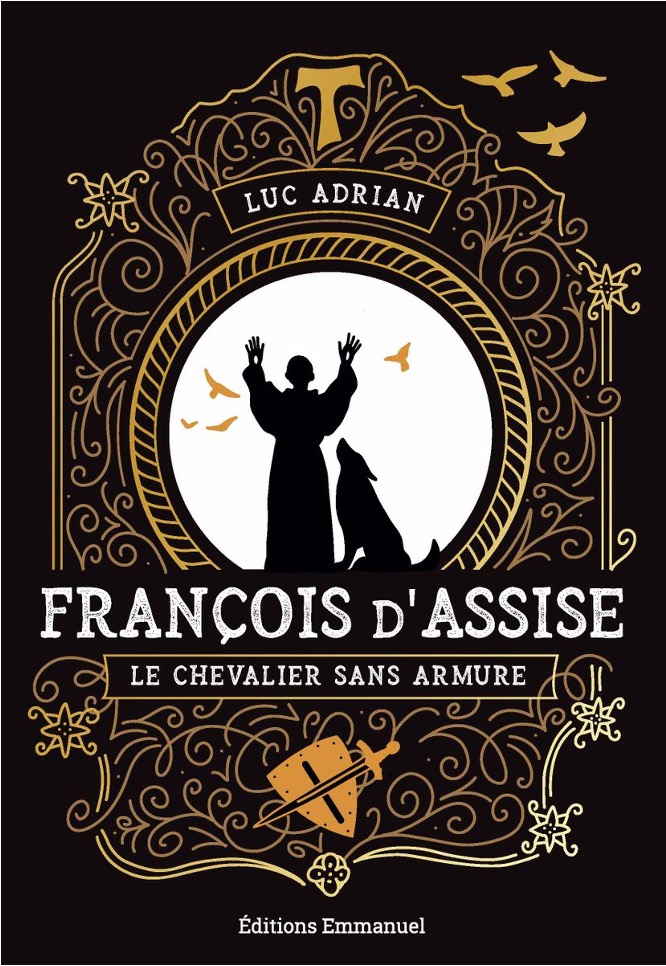
Le commander 👉 c’est ici
Plus biographique qu’hagiographique, le récit de la vie de François d’Assise que propose le livre de Luc Adrian s’apparente à un roman pour la jeunesse. L’initiative est louable : on ne peut reprocher à l’auteur et à l’éditeur leur volonté de présenter le Poverello aux nouvelles générations et de restituer le monde dans lequel il vécut, sa famille, la société médiévale, les crises politiques et religieuses qui l’agitèrent. Toutefois, ceux que la spiritualité franciscaine et la personnalité de son fondateur avaient antérieurement touchés ne découvriront rien qu’ils n’aient déjà appris, et continuent d’apprendre, dans l’abondante littérature de qualité sur ces sujets ainsi que dans leur pratique d’échanges fraternels. Ils pourraient même s’agacer de ce que laisse présager le titre de l’ouvrage : une tentative de faire de Giovanni di Pietro Bernardone un personnage de légende, une sorte d’anti-héros médiéval, une « star » du temps des croisades, en contradiction fondamentale avec la foi et l’exemplarité évangéliques de saint François.
La vulgarisation tend toujours le piège d’une simplification trop réductrice ou d’un dévoiement tel qu’elle finit par n’être que vulgarité, et le danger est évidemment plus grand encore dans l’ordre de la spiritualité. Si l’objectif de Luc Adrian était d’atteindre et de séduire un public jeune afin de lui faire connaître l’homme que fut François d’Assise, on ne peut lui reprocher de s’être attaché avant tout aux aspects biographiques de ce qu’il faut bien appeler le « personnage » de son roman, et cela au détriment de notions moins spectaculaires, moins immédiatement séduisantes et compréhensibles aux adolescents. Mais ce qui gêne dans ce livre, c’est le ton général, ce sont les artifices que l’auteur utilise pour accrocher son lecteur. Son récit joue ainsi presque constamment sur des effets d’anachronisme entre notre époque et le Moyen-Âge, ressort comique éculé de films comme « Les Visiteurs ». Ce pourrait être judicieux, à la rigueur, s’il ne puisait pas la plupart de ses références modernes dans la pseudo-culture de divertissement la plus ordinaire, et s’il s’était attaché plutôt à trouver des correspondances plus éclairantes, et aussi plus élégantes, dans et pour notre époque. Pour compenser sa tendance à un jeunisme par ailleurs tout à fait dépassé, il se lance çà et là dans des explications lourdement édifiantes dans lesquelles il n’abandonne pourtant pas le langage néo-argotique qu’il croit celui des jeunes d’aujourd’hui, ni ses incessantes plaisanteries qui sont trop évidemment destinées à amuser pour ne pas tomber à plat. Il résulte de tout cela le sentiment que Luc Adrian, dont on devine malgré tout la qualité d’auteur et l’authenticité de l’intérêt pour son sujet, a pris délibérément un parti iconoclaste dans le but de rendre plus abordable la sainteté de François d’Assise. Il y a là une contradiction intenable : si l’on veut initier quelqu’un — fût-il, et à plus forte raison, un enfant — à une beauté qui lui est supposée inaccessible, ce n’est certes pas en la maquillant de laideur commune qu’on y parviendra. Encore une fois, vulgariser ne doit pas signifier abaisser, mais élever.
Ce livre illustre une certaine difficulté que rencontre l’Église contemporaine à trouver une manière juste de s’adresser aux populations qui la méconnaissent ou la rejettent. Elle y parvient en se montrant compréhensive, à l’écoute, en adaptant judicieusement son discours, mais cela sans rien renier de sa conviction, de son langage ni de son message, en un mot de sa mission. De ce point de vue, et sur le thème le plus cher aux franciscains, ce roman est un échec exemplaire. Il est un concentré de ce que l’on pourrait appeler sévèrement « le mauvais goût catholique », celui qui se veut actuel, à la portée de tous, mais qui ne parle à personne, simplement parce qu’il se laisse séduire par l’époque et doute de la puissance intrinsèque de ce qui fonde sa foi. Tout le contraire, en somme, de saint François.
Jean Chavot
