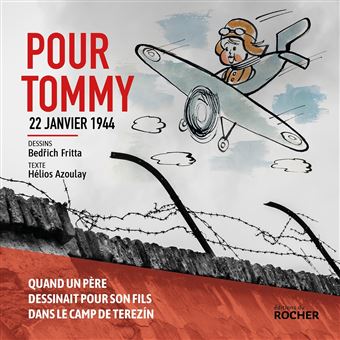Éternel MUCHA : un artiste humaniste père de l’art nouveau

En savoir + 👉 c’est ici
La Révolution industrielle contribua à dynamiser l’économie, le commerce et la vie culturelle. La presse, l’édition, le théâtre, les spectacles, les loisirs sollicitaient la publicité qui se développa spectaculairement. Les affiches publicitaires devinrent l’une des manifestations de l’expansion commerciale et furent souvent perçus comme des objets culturels et esthétiques. Les travaux haussmanniens en couvrant Paris de palissades offrirent des supports privilégiés aux affiches. L’urbanisation, l’expansion du monde ouvrier et de la bourgeoisie contribuèrent au débat afférent à la démocratisation de l’art et à l’embellissement des rues ; autant de facteurs propices au développement de l’affiche. C’est dans ce contexte que l’artiste-affichiste tchèque Alfons Mucha trouva la célébrité, celle d’une figure de l’Art nouveau parfois qualifié de « style nouille ». Ce style c’est celui des courbures élégantes, des arabesques de fleurs, de végétaux, de motifs naturels, de figures élancées de femmes sensuelles, idéalisées aux longues chevelures ondoyantes ; telles d’éthérées icônes byzantines apparaissant dans des nimbes oniriques. Végétaux, silhouettes et contours ornementaux sont de couleurs aux tons doux et pastel.
Le Grand Palais Immersif, contigu à l’opéra Bastille, nourrit l’ambition de présenter l’univers singulier de « l’éternel Mucha » à la faveur de projections géantes en offrant parfois au visiteur l’opportunité de s’allonger confortablement afin de profiter des réalisations graphiques. Animations interactives, ambiance musicale et créations olfactives se découvrent au fil d’une flânerie en trois actes : l’affichiste, l’Exposition universelle de 1900 et l’affirmation des racines slaves de Mucha dans le contexte nationaliste généré par le crépuscule des grands empires continentaux. L’interactivité permet même de créer sa propre affiche en s’inspirant de l’artiste, de ses modèles et compositions florales et de s’adresser la création par voie électronique.
Le premier acte est visuel. Il se déploie dans une pièce immense au plafond à hauteur démesurée, dotée d’un écran géant sur lequel apparaissent progressivement, à la faveur d’images de synthèse, un mélange d’affiches de publicité, de théâtre ; de notes biographiques et contextuelles. La célébrité de cet artiste survint avec l’affiche Gismonda, drame de Victorien Sardou au Théâtre de la Renaissance, avec la « Divine », la « voix d’or » Sarah Bernhardt. 4 000 affiches à placarder sur les murs de Paris. Tous les artistes de l’imprimeur étant alors en vacances, c’est le jeune Mucha auquel fut confiée la réalisation de la commande. Séduite par l’image d’une femme mystérieuse qui n’est pas seulement l’annonce d’une représentation théâtrale mais qui attire aussi le passant, la tragédienne devint sa muse. La diva lui offre un contrat de six ans, l’introduit dans le milieu du théâtre, dans les cercles mondains, et lui apporte la renommée.
Mucha imagine un nouvel idéal féminin à la beauté en harmonie avec la nature, la chevelure cernée de traits noirs, s’échappe et se prolonge pour devenir à son tour un motif linéaire. La femme est omniprésente dans l’œuvre de Mucha y compris lorsqu’il abandonne les affiches pour se consacrer à la gloire des peuples slaves. Avec lui, l’affiche n’est plus description, elle devient un art à part entière.
À la demande de l’Empereur François-Joseph, il est chargé de décorer le pavillon de la Bosnie-Herzégovine à l’Exposition Universelle de 1900. C’est l’événement mondial qui fit entrer à nouveau la France dans le concert des grandes puissances qu’elle avait quitté après le désastre de 1870. Bilan d’un siècle ou aurore de temps heureux ? Ce fut une manifestation de ce que l’on nomma avec une illusion nostalgique : la « Belle Époque ». Trottoir roulant à deux vitesses, grande roue, immense lunette astronomique, Jeux Olympiques d’été, métro parisien, exposition « nègre », fée électricité ; tant de « progrès » qui inspirent « l’Art nouveau ».
Mucha, épris de liberté, initié, engagé dans le combat politique aspirant à l’émergence des nations, artiste philosophe et humaniste espérant un monde meilleur, sollicite son talent artistique pour défendre une cause qui lui est chère : celle des peuples slaves soulevant le joug austro-hongrois. La magnifique Épopée slave est composée de vingt gigantesques tableaux ; vision inspirée du symbolisme, mêlant réalisme et fantastique, avec la voix de Mucha qui résonne lors d’un discours en tchèque. Il appelle au respect de l’identité mais aussi des différences culturelles. Ce franc-maçon n’était pas pour autant insensible aux élans mystiques ; très impliqué dans le courant spiritualiste et la théosophie, il crée une version illustrée du Pater noster en 21 planches.
Le parcours s’achève par une présentation de l’influence de l’esthétique Art nouveau sur certains artistes de rue, tatoueurs, créateurs de comics, d’affiches de concert, de pochettes de disques, de jeux vidéo, …
En définitive, c’est un beau voyage dans les créations du pionnier de l’art de l’affiche, dans l’œuvre d’un homme de son temps. Des cinq sens aristotéliciens, seul le goût n’est pas sollicité par ce spectacle. Les inconditionnels de Mucha tel l’ancien tennisman Yvan Lendl, y trouveront leur compte mais force est d’estimer le « spectacle » comme un peu court et de déplorer l’absence d’œuvres originales. Le tarif de 20 euros paraît par ailleurs quelque peu excessif. Dès lors, pourquoi ne pas terminer cette pérégrination dans l’univers de l’artiste morave en portant ses pas jusqu’au musée Carnavalet, dont l’accès est gratuit, afin d’admirer la reconstitution de la splendide devanture de l’orfèvre et joaillier Georges Fouquet réalisée par Mucha ?
Érik Lambert.
Analyse de la déraison
Un livre d’Augusto del Noce

Site de l’éditeur 👉 Par ici
Les catholiques regardent parfois la politique avec distance, méfiance, voire avec répugnance : certes, ce n’est pas d’elle qu’ils attendent le salut ni en elle que les vertus s’expriment le mieux. Mais les catholiques sont aussi des citoyens, auxquels leur exigence morale interdit de se désintéresser du sort commun. Ce livre propose des outils précieux à qui cherche à mener son activité politique selon les principes auxquels il s’applique à conformer sa conduite, ce qui exige le double effort de raison garder devant les injonctions progressistes comme de s’affranchir du soutien automatique à l’ordre établi, trop longtemps de règle dans l’Église.
« Analyse de la déraison » rassemble 71 articles rédigés de 1945 à la fin des Trente Glorieuses par Augusto del Noce (1910-1989), sénateur démocrate-chrétien dans ses dernières années et avant tout philosophe italien de premier ordre, méconnu en France comme presque toute la tradition philosophique transalpine pourtant d’une richesse et d’une qualité enviables. Regroupés en trois parties : « Adversaires et approfondissements » ; « Sur la question du divorce » ; « Analyse du langage politique – Christianisme et politique », chacun des articles présente une réflexion approfondie sur les causes et les conséquences de l’athéisation de la société, éclairée par une conceptualisation solide et nourrie de considérations historiques sur des phénomènes que l’auteur a vu se former, se développer et dont il pressentit l’actualité dont nous sommes aujourd’hui les témoins désemparés.
La première partie constate la transformation de la société en « société permissive » — c’est-à-dire dépourvue d’autre principe directeur que celui de la recherche anarchique du bien-être immédiat — sous l’action conjuguée de forces hétérogènes et apparemment contradictoires : marxisme ; révolution sexuelle ; fascisme ; anti-fascisme ; surréalisme ; scientisme ; freudisme… Il n’y est plus perçu l’autorité, principe auquel Augusto del Noce consacre une passionnante étude en rappelant (par son étymologie augere) que l’autorité n’impose pas, mais accroît, fait grandir, et qu’elle se fonde sur la transcendance et non pas sur une quelconque hiérarchie sociale, surtout pas celle que domine une bourgeoisie capitaliste dont la vocation au progrès utilitariste préside à une involution que le philosophe de l’histoire fait remonter aux Lumières. Il montre en outre qu’une permissivité de cette sorte, loin de conduire à une quelconque libération, est la voie royale d’un nouveau totalitarisme : le « totalitarisme de la dissolution », entendons dissolution des valeurs.
La deuxième partie traite de la question du référendum de 1974 pour ou contre l’abrogation de la loi sur le divorce, question tout italienne en apparence, mais qui donne un exemple très convaincant de la manière dont le pseudo-libéralisme cache l’installation du totalitarisme qui s’emploie à la dissolution des vertus traditionnelles considérées comme obstacle au progrès alors qu’au contraire elles structurent indispensablement la liberté. Mais si del Noce récuse cette sorte de progrès qui consiste d’abord à nier Dieu, il réprouve autant le conservatisme étroit qui tue toute dynamique de la tradition — ou transmission, du latin tradere — dont il est vital d’entretenir la dynamique d’actualité toujours renouvelée.
Enfin, la troisième partie explore les termes et pratique de la politique tels qu’un chrétien peut les concevoir en conformité avec ses valeurs afin que celles-ci soient respectées pour le bien commun, en particulier le rejet absolu, au profit de la seule persuasion, de toutes violence et coercition. Del Noce invite à ne pas se laisser abuser par des oppositions dont le spectaculaire masque la réalité des pratiques et des intentions néfastes qui leur sont communes. Ainsi dans l’Italie encore (et toujours !) marquée par le fascisme et l’anti-fascisme discerne-t-il en ceux-ci des modes d’action et de pensée analogues, non pas avec la facilité de qui renvoie les adversaires dos à dos, mais en dénonçant leur commune erreur fondamentale : la négation de la transcendance dont le résultat, qu’il soit révolutionnaire ou réactionnaire, est tôt ou tard le totalitarisme, et c’est là un enseignement d’une inquiétante actualité pour nous : un totalitarisme nécessairement nouveau car jamais il n’apparaît sous la forme attendue.
Augusto del Noce n’est pas un homme d’opinion ; c’est un philosophe au travail avec une rigueur irréprochable, une culture d’une ouverture exceptionnelle et une hauteur de vue étonnamment exempte de préjugés d’où il examine idéologies et Histoire. Il fallait une solide raison pour analyser la déraison…Son éditeur et traducteur français, Christophe Carraud, choisit un titre parfaitement judicieux pour ce recueil d’articles qu’il a lui-même rassemblés, annotés, et dont chacun peut être lu pour lui-même avec grand profit. Que ces 752 pages ne dissuadent donc pas les bonnes volontés de cette lecture providentielle !
Jean Chavot