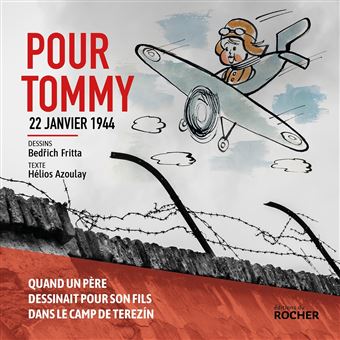Le Nageur
Un livre de Pierre Assouline

Le Nageur, Paris, Gallimard, 2023,
256 pages, 20 €
Il y a des histoires de vie plongées dans la « grande histoire » qui demeurent ignorées. Le récent livre de Pierre Assouline lève le voile sur la tragédie que vécut un nageur méconnu, même si quelques piscines portent son nom : Alfred Nakache. Il fut pourtant une célébrité durant les années 1930 et dans l’immédiat après-guerre. Son histoire est celle des juifs de France durant les années sombres, elle est aussi celle d’une rivalité humaine. Même si un certain polémiste, éphémère candidat à la magistrature suprême l’oublie ou se vautre dans le mensonge, c’est bien Philippe Pétain qui abolit le décret Crémieux et déchut les Juifs d’Afrique du Nord de la nationalité française. Or, Alfred Nakache fit partie de ces juifs français qui perdirent leur qualité de Français. Pierre Assouline, bon connaisseur des années sombres, adepte des longueurs de piscine, rend hommage au petit gars de Constantine. La trame chronologique repose sur la rivalité qui scelle probablement le sort du nageur d’Auschwitz. L’avenant, souriant et résistant, fruste nageur, Alfred Nakache et l’élégant brasseur, flambeur antisémite, milicien, collaborateur, Jacques Cartonnet. Deux nageurs qui s’affrontaient à coups de records de France et d’Europe ; des collectionneurs de titres nationaux qui s’opposaient même dans leurs styles de nage. Soutenu par la plupart des autres nageurs d’alors, relativement protégé par les victoires apportées à la France, soutenu par le commissaire général-tennisman bondissant pétainiste Jean Borotra[1], Nakache fut victime de la presse collaborationniste « le Youtre le plus spécifiquement youtre de la Youtrerie[2] » et très probablement dénoncé par son rival : « Si je le revois, je le tue » aurait dit « Artem »[3]. Nakache, le juif algérien subit le sort de ses coreligionnaires, déporté avec sa femme et sa fille de deux ans, gazées à leur arrivée à Auschwitz. Il survit, un matricule tatoué sur le bras ; les SS l’obligeant à plonger afin de chercher les clés et les cailloux qui étaient lancés au fond d’une citerne d’eau croupie et glacée. Les sadiques aimaient en effet humilier les talentueuses victimes de la folie nazie. Les gardiens organisaient ainsi des matchs de football entre SS et Totenjüden à Belzec[4] ou entre SS et Sonderkommandos à Auschwitz ; des combats de boxe entre des champions devenus faméliques et des brutes présentes dans les camps.
Évacué à la faveur des marches de la mort, il vit mourir le boxeur Young Perez[5], avant d’être libéré de Buchenwald par les Américains. Sorti de l’enfer des camps, donné pour mort, cadavérique, il participa toutefois aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 et reprit son métier de professeur de sport. C’est à Cerbères que le licencié du TOEC mourut à 67 ans en pratiquant sa natation quotidienne.
Outre de tristes histoires de vie, le livre est aussi celui d’un écrivain féru de natation, sensible à l’histoire d’un enfant qui a surmonté sa peur de l’eau lorsque ses camarades quelque peu espiègles lancèrent ses chaussures dans l’eau, qu’il dut récupérer pour éviter l’ire familiale. C’est aussi celui d’un homme qui surmonta l’horreur grâce à la passion qui l’animait. L’ouvrage précis et documenté, foisonne de détails, d’anecdotes parfois inédites telle celle qui rappelle que les déportés devaient coudre les poches de leurs pantalons car les Allemands trouvaient arrogant qu’ils se promènent les mains dans les poches.
On peut être rétif au style très particulier de Pierre Assouline mais, en des temps où le souvenir des horreurs du joug nazi s’estompe, à une époque où l’on ose affirmer sans ciller que le seul régime de collaboration d’Europe qui ne fut pas mis en place par les nazis protégea ses juifs nationaux, savoir ce que fut la vie d’Alfred Nakache contribue à appréhender ce que fut la réalité d’un régime criminel.
Érik Lambert.
[1] Remplacé le 18 avril 1942 par Joseph Pascot.
[2] Je Suis partout,
[3] « Le poisson » en hébreu, surnom donné à Alfred Nakache
[4]https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/Source/Documents/MCP/bordeaux/HK_Bordeaux_Le_sport_europeen_a_lepreuve_du_nazisme.pdf
[5] Boxeur juif originaire de Tunisie, champion du monde poids mouches en 1931, déporté en 1943. Un film Victor Young Perez est sorti en 2013.
Degas en noir et blanc
A voir à la BNF jusqu’au 03 septembre 2023

Qui ne se souvient des innocentes ballerines qui s’évertuaient autrefois à décorer les couloirs de nos écoles ? Ces reproductions aux couleurs passées portaient la signature d’Edgar Degas. Elles en côtoyaient d’autres de Pissaro, Monet, Renoir… comme dans une exposition du mouvement impressionniste dont il fut l’un des fondateurs. Ce serait une ignorance coupable de ne voir en lui que le peintre des petits rats de l’Opéra tant son œuvre est d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles. L’exposition présentée jusqu’au 3 septembre à la Galerie Mansart de la Bibliothèque nationale de la rue Richelieu (infiniment plus élégante que son rejeton mitterrandien) est une excellente occasion, pour 10 € tout au plus, de faire connaissance avec une facette moins connue de l’un des plus grands et plus audacieux artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Et pour trois euros de plus, il est possible de visiter tout le site après son heureuse rénovation achevée l’année dernière, notamment son musée, sans oublier de glisser un regard dans sa magnifique salle ovale où se sont escrimées des générations de chercheurs plus ou moins studieux.
Comme son titre l’indique, l’exposition est consacrée à la prédilection de Degas pour le noir et blanc, c’est-à-dire à sa recherche de la nuance lumineuse menée tout au long de sa vie en utilisant les ressources du crayon, du fusain, de la plume ou du lavis, et de toutes les techniques de gravure ou d’estampe — eau forte, aquatinte, pointe sèche, monotype, vernis mou, lithographie… (une vidéo les présente au public) — qu’il a lui-même développées ou renouvelées avec une inventivité extraordinaire, afin de saisir une incomparable qualité de clair-obscur telle qu’il la percevait dans les lieux fermés, caf’conc’, théâtres, coulisses, cabinets de toilette féminins, intérieurs bourgeois, sans oublier les maisons closes où il promena son regard sur les nuances subtiles de l’ombre qui caresse la chair et enténèbre les chevelures. Il employa sa capacité à capturer le mouvement pour croquer des instantanés si troublants de vérité poétique que ses contemporains, dans son époque de profonde mutation, semblent nous parler aujourd’hui de leur humanité inaltérable. On peut deviner en cela son goût prononcé pour le coup d’œil et de crayon d’un Daumier ou d’un Gavarni, entre autres, dont il collectionna les estampes, et aussi comprendre sa dernière passion presque compulsive — de son propre aveu — pour la photographie dont l’exposition nous donne de beaux exemples. Son esthétique particulière ne s’y dément pas malgré la nouveauté de l’artifice technique, autre preuve du génie de l’artiste par ailleurs éclatant dans les nombreux chefs-d’œuvre parmi la soixantaine de réalisations que l’exposition nous donne à découvrir.
Elle est organisée selon l’évolution chronologique des expérimentations d’Edgar Degas, accompagnées par des amis tels que Camille Pissaro, Mary Cassatt, Felix Bracquemont et bien d’autres, de ses premières copies de Rembrandt ou de Dürer à la réinvention du monotype dont il fait lui-même les tirages, chaque fois différents, en passant par la création d’une revue intitulée Le jour et la Nuit, qui restera lettre morte, jusqu’à sa pratique novatrice de la lithographie retravaillée qui donne lieu à la merveilleuse série de ses « nus de femmes à leur toilette ». Il contrôle l’impression de ses gravures afin que chacune soit, non pas une répétition, mais une étape de sa recherche expressive toujours plus avancée, quitte à les retravailler à l’aide de différentes techniques graphiques et picturales pour en faire des « dessins imprimés » — comme il nommait lui-même ses estampes. Manquant de moyens financiers pour poursuivre ses coûteuses innovations et surtout souffrant de graves problèmes oculaires, il se consacra plus particulièrement à la sculpture et au pastel avant que la cécité puis la surdité ne l’entraînent dans la misère, jusqu’à son enterrement à l’automne 1917, à 83 ans, où ce géant de l’art ne voulut d’autre discours d’hommage que : « Il aimait le dessin. »
Jean Chavot