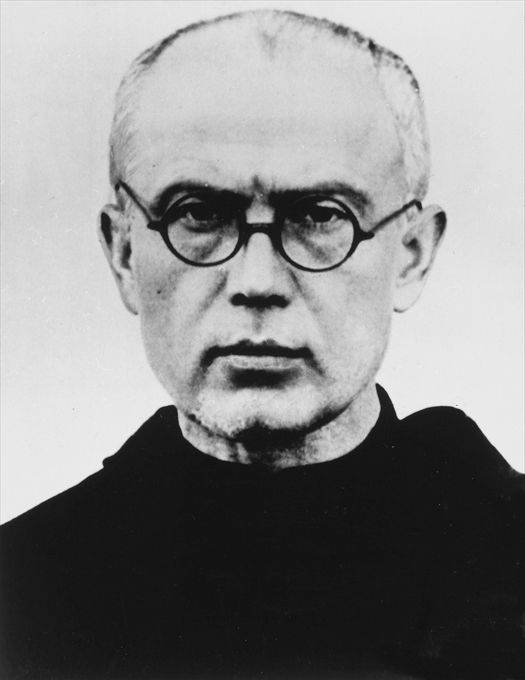Le XIII° siècle est essentiel pour l’ensemble de l’Europe. Si l’époque fut assombrie par les disettes, les maladies et l’insécurité ; elle était éclairée par la foi et la confiance en l’avenir. L’Église, fut très impliquée dans les affaires séculières et constitua un acteur majeur de l’Histoire du Moyen Âge : calendrier scandé par les fêtes religieuses, cloches rythmant la vie de toute la population ou appelant les hommes à se rassembler, elle structurait aussi l’espace, les gens se regroupant autour de l’église, des monastères et du cimetière.
L’Église sanctifiait par ailleurs un ordre social inégalitaire. La société d’alors était en effet hiérarchisée et cloisonnée selon une distinction échafaudée dès avant l’An Mil par les clercs. Au sommet se tenaient ceux qui priaient (qui orant) pour le salut commun ; donc, les clercs eux-mêmes. Ensuite venaient ceux qui combattaient (qui pugnant) et protégeaient chacun à la force de leurs bras, enfin les plus nombreux, les paysans, artisans et marchands qui devaient travailler et assurer la subsistance de la collectivité (qui laborant en latin). Cet ordre social fondé sur les relations d’homme à homme, à la fois hiérarchisé et cloisonné, fut qualifié rétrospectivement par les historiens de féodalité(mot dérivé de fief ou peut-être du latin feudus, qui se rapporte à la confiance).
Or, dans cet ordre, une place restreinte était laissée aux femmes, considérées, à la suite d’Ève, comme des tentatrices qui incitaient au péché. Toutefois, cette configuration les protégeait aussi en imposant l’indissolubilité du mariage et en interdisant la répudiation. En cette période du Moyen Âge (XI°-XIII° siècle), les sociétés se stabilisèrent, reposant sur le droit. L’Église médiévale jouissait d’une influence incontestée. D’un concile à l’autre, elle imposa ses préceptes moraux jusque dans les campagnes les plus reculées. C’est ainsi que le grand concile œcuménique de Latran IV en 1215, jeta les bases du mariage chrétien, qui ne changèrent plus guère jusqu’à la Révolution française. Considéré comme un sacrement, le mariage devint un acte religieux central, symbolisant l’union de l’homme et de la femme sous le regard de Dieu. Cette sacralisation du mariage par l’Église catholique renforça son rôle dans la société médiévale.
Les mariages, en particulier au sein de la noblesse, et, a fortiori, au niveau des pouvoirs monarchiques, étaient des outils stratégiques et diplomatiques. Ils pouvaient être utilisés pour sceller des alliances entre royaumes ou pour apaiser des conflits.
Au cœur de l’Europe médiévale, la Hongrie, jouait le rôle de charnière entre l’empire byzantin et le monde germanique. Le roi Béla III prit modèle sur les monarchies occidentales et jeta les bases de la féodalité. Son fils André II Árpád, surnommé André II le Hiérosolymitain (qui vient de Jérusalem), conduisit la cinquième croisade entre 1217 et 1218, croisade qui se solda piteusement. Malade et découragé, André II rentra en Europe. Ce roi « hongrois » et sa première épouse, Gertrude de Méranie, eurent cinq enfants dont le troisième était une fille prénommée Élisabeth. Pour contribuer à la politique matrimoniale des landgraves, Élisabeth, née à Preßburg[1] en 1207, fut, à l’âge de quatre ans, fiancée au fils du landgrave de Thuringe[2], Louis IV surnommé « Le Saint », qui en avait onze, et fut conduite au château de la Wartburg[3]. Landgrave en 1217, Louis épousa Élisabeth en 1221 ; elle avait alors quatorze ans. Les deux époux eurent trois enfants : en 1222, Hermann, le futur landgrave ; en 1224, Sophie, qui épousa le duc de Brabant ; en 1227, Gertrude, qui devint abbesse d’Altenburg[4].
Élisabeth reçut une éducation due à son rang dans laquelle la religion prenait une place essentielle. Si sa famille n’était guère favorable à ce qu’elle considérait comme un excès de piété, Élisabeth puisait sa force dans sa foi pour affronter les épreuves. Sa grande piété la fit juger indigne de la cour, notamment par sa belle-mère Sophie de Bavière qui la trouvait trop extravagante dans sa foi. Ainsi, en entrant dans une église la jeune reine déposa sa couronne au pied de la croix. Sa belle-mère le lui reprocha, estimant que c’était là un comportement indigne d’une princesse. Élisabeth lui répondit qu’elle ne saurait porter une couronne d’or quand le Seigneur portait une couronne d’épines.
Par bonheur, son mariage avec Louis la conforta dans sa pratique religieuse car son mari partageait sa foi.
Des franciscains venus d’Allemagne initièrent la landgravine à la sensibilité franciscaine ce qui l’incita à se mettre au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. Généreuse, empreinte de charité chrétienne, elle consacrait des heures quotidiennes au travail manuel afin de confectionner des vêtements pour les pauvres. Parmi les malheureux, elle affectionnait surtout les lépreux dont elle lavait les plaies. Un jour, elle soigna et plaça dans son propre lit un enfant souillé de la lèpre.
À la mort brutale de son époux Louis IV à Otrante le 11 septembre 1227, alors qu’il partait rejoindre la croisade de Frédéric II au royaume de Jérusalem[5], Élisabeth dut quitter le château de la Wartburg dans des circonstances fort pénibles. En effet, les membres de la famille héritaient des biens familiaux qui demeuraient indivis, et les revenus étaient donnés à la veuve. Mais le frère de Louis, Henri Raspe IV arriva au pouvoir en tant que régent et tuteur du landgrave Hermann II, le fils de cinq ans de Louis. Veuve à l’âge de vingt ans à peine, Élisabeth, refusa d’être remariée et Henri la bannie et ne lui permit plus de disposer librement de ses revenus. Chassée en plein hiver, elle fut contrainte de mener une vie précaire à Eisenach avec ses suivantes et ses trois enfants en tissant la laine pour subvenir à̀ leurs besoins.
Des membres de la famille comme sa tante maternelle Mechtilde, abbesse du couvent bavarois des bénédictines de Kitzingen, restés fidèles à sa légitimité la défendirent. En 1228, au retour des croisés rapportant les restes de son mari, une réconciliation familiale eut lieu qui lui permit de recouvrer ses droits. Ainsi, reçut-elle son douaire[6], dotation suffisante pour se retirer au château familial de Marburg. Sans ses enfants confiés à la famille, elle vécut avec quelques compagnes et, avec l’accord de son confesseur, son oncle évêque de Bamberg, Ekbert, fit vœu de renoncer au monde, dans la chapelle des franciscains d’Eisenach, le vendredi saint 1228 en prenant, ainsi que ses servantes, l’habit gris des pénitents. Elle ne garda pour elle qu’une modeste demeure, consacra le reste de sa vie à la prière et aux œuvres de charité, mit alors tous ses revenus au service des pauvres contribuant à la construction d’un hôpital au service des malades et des moribonds. À la demande du cardinal Hugolin, futur Grégoire IX, François d’Assise donna son manteau à Elisabeth en gage de leur lien spirituel. Elle le conserva près d’elle ce manteau jusqu’à sa mort : elle le considérait comme son « bijou le plus précieux ».
Élisabeth se dévoua totalement aux pauvres et aux malades et mourut d’épuisement, à l’âge de 24 ans, dans la nuit du 16 au 17 novembre 1231. Elle devint la patronne du tiers ordre régulier de Saint-François et de l’ordre franciscain séculier.
Rapidement vénérée comme une sainte, de nombreux miracles furent attribués à son intercession. Ainsi, se rendant à Eisenach, à pied, par un petit sentier très rude, portant dans son manteau du pain, de la viande, des œufs et autres mets destinés aux malheureux, elle rencontra son mari qui lui demanda ce qu’elle cachait dans son tablier. Elle lui répondit qu’il s’agissait de roses puis finit par lui avouer qu’en réalité c’était des pains et ouvrit son tablier dans lequel apparut un bouquet de roses. Ce « miracle des roses » et les nombreux témoignages attestant de sa sainteté firent que, seulement quatre ans après sa mort, le pape Grégoire IX la proclama sainte.
Humble, charitable, dévouée aux pauvres, elle fut parfois considérée comme la » seconde sainte Claire » ! Sa fête, introduite au calendrier romain en 1670, à la date du 19 novembre, anniversaire de son enterrement, a été ramenée, en 1969, au 17 novembre, anniversaire de sa mort.
Érik Lambert.
[1] La ville porta ce nom sous la domination austro-hongroise. À partir de 1919, elle devint Bratislava, désormais capitale de la Slovaquie.
[2] Les landgraviats étaient des circonscriptions administratives du Saint-Empire romain germanique créées vers la fin du Moyen Age classique (Moyen Âge dit « classique » ou « central », qui s’étend aux XIe, XIIe, XIIIe et XIVe siècles dans la conception des historiens allemands et anglo-saxons) pour servir de cadre à la représentation du pouvoir impérial et au maintien de la paix publique, tout en fonctionnant comme instances judiciaires pour les hommes libres. Tous étaient situés au sud-ouest de l’Empire. Les landgraves de Thuringe comptèrent parmi les princes les plus puissants de l’Empire, ils devaient cependant se défendre contre la concurrence des archevêques de Mayence. Elle est actuellement située dans le centre du pays, au nord de la Bavière. Le terme Thuringe désigne une grande diversité de territoires et d’entités politiques, aux délimitations différentes selon les époques : un royaume aux Ve et VIe siècles, puis des duchés ; sous le Saint Empire, la Thuringe devient une marche, un landgraviat, puis un comté. Celui-ci est éclaté au XIIIe siècle entre le landgraviat de Hesse et le duché de Saxe et, au XVe siècle, en de multiples États.
[3] À proximité de la ville d’Eisenach. Le nom a été utilisé par le pouvoir est-allemand pour une marque de voiture presqu’aussi iconique que la Trabant. Au printemps 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’usine BMW située à Eisenach, en Thuringe, fut confisquée et nationalisée par les autorités d’occupation soviétiques. Rapidement relevée de ses ruines, celle-ci parvint même à reprendre la production des voitures, ainsi que celles des motos, quelques mois seulement après la fin des hostilités. En 1955, l’usine, rebaptisée AWE (pour AutomobilWerk Eisenach), abandonna toutefois la production des anciens modèles BMW au profit d’un nouveau modèle inédit, la Wartburg 311. (Un nom choisit en référence, à la fois, au célèbre château du même nom qui domine la ville d’Eisenach et qui servit de lieu d’asile à Martin Luther, le fondateur du protestantisme, ainsi qu’au nom que porta également la première voiture construite à Eisenach, en 1898).
[4] L’abbaye d’Altenburg est une abbaye bénédictine fondée en 1144 à Altenburg, en Basse-Autriche proche de la frontière Tchèque. Suite à la guerre de Trente Ans, elle fut reconstruite en style baroque au XVIIIème siècle. Elle dispose d’une bibliothèque impressionnante forte de 25 500 ouvrages dont 150 incunables, 358 imprimés antérieurs à 1540 et 950 pour le reste du XVIème siècle.
[5] Pèlerinage armé, la « croisade » fait la synthèse entre le « pèlerinage à Jérusalem » – lequel vaut rémission des péchés – et la « guerre juste » contre les ennemis de l’Église. Pour le pape, c’est aussi le moyen de rassembler sous la bannière de l’Église la chevalerie d’Occident et d’imposer sa prééminence sur toute la chrétienté. Huit croisades se sont succédé entre 1095 et 1270, engageant plusieurs centaines de milliers de chrétiens. Il s’agit ici de la VI°croisade (1228-1229) durant laquelle Frédéric II reprit Jérusalem qui n’était plus aux mains des chrétiens depuis 1187, grâce à ses talents de diplomate plutôt qu’aux combats. En février 1229, un traité fut conclu avec le sultan d’Égypte et de Syrie, al-Kâmil, qui remit la Ville sainte aux chrétiens. Ainsi, la sixième croisade réussit à obtenir par des moyens pacifiques ce que les quatre croisades sanglantes précédentes n’avaient pas réussi à faire.
[6] Biens qu’un mari assignait à sa femme lors du mariage et dont elle jouissait en propre si elle lui survivait.